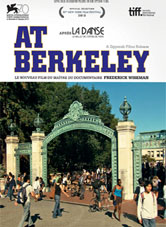At Berkeley
Frederick Wiseman, 84 ans, vétéran américain du documentaire, a posé sa caméra sur le campus de Berkeley, Californie, l’une des plus prestigieuses universités des États‑Unis.
Armé d’une méthode minimaliste mise au point dès ses premiers films (pas de voix off, pas de cartons, aucun effet de distanciation, juste le montage et la parole des intéressés), ce passionné du fonctionnement des institutions dresse dans ce film marathon « le portrait d’une grande université publique se démenant avec succès pour surmonter une crise financière majeure tout en préservant ses grands principes et son envergure internationale ».
Le désengagement brutal de l’État de Californie, qui a réduit son aide budgétaire à moins de 9% du budget global de l’Université, constitue le principal sujet de discussion entre étudiants et professeurs, hautes autorités de l’administration et instances locales, stars de la fac (Prix Nobel et anciens membres de l’administration Clinton) et petites mains (jardiniers, cuisiniers). Soit autant de rouages que Wiseman met sur un pied d’égalité, comme un gigantesque organisme fondé sur l’interdépendance.
Comment éviter que Berkeley n’emprunte la pente exclusivement libérale de ses concurrents privés que sont Harvard ou Standord ? Augmenter encore le coût des inscriptions et étouffer un peu plus les étudiants les plus modestes ? Baisser le salaire des enseignants au risque de les voir céder, ailleurs, à des conditions financières plus alléchantes ?
La puissance de At Berkeley tient en partie dans le refus de Wiseman de céder aux sirènes attendues de l’alter‑discours de circonstance (comment la recherche du profit aurait écrasé les autres humanités) et de déplier au maximum toutes les facettes de son sujet : ainsi, le film fait alterner réunions de crise entre les membres de l’administration, étudiants et professeurs, et de longues séquences de classe (et de grâce) où l’on se surprend à écouter, fascinés, des cours en particulier (de philosophie, de médecine, de littérature) et à éprouver le plaisir de voir des idées exposées.
Wiseman n’omet rien des difficultés, des fêlures, des plaies de l’Histoire nationale toujours vivaces, qu’il s’agisse de l’intégration problématique des Afro‑Américains, des étudiants issus des classes moyennes blanches touchés par la crise et leur intérêt soudain pour la question de la pauvreté, et de ce passé emblématique qui sans cesse remonte à la surface : l’utopie des Sixties, Berkeley, 1964 qui a vu naître le Free Speech Movement et les manifestations anti‑Vietnam. Cinquante ans plus tard, tout a changé mais cette frontière romantique demeure, fantôme du permanent, référence constante des étudiants eux‑mêmes.
Mais au fond, At Berkeley parle surtout du monde contemporain, de ses idéaux, de ses impasses, mais aussi de ce qui tient encore, de ce qui émerveille, de ce qui fonctionne, de cette capacité si américaine à discuter, à bavarder, à se remettre en question : le melting‑pot, l’idée que l'Amérique est un work‑in‑progress. Une merveille.