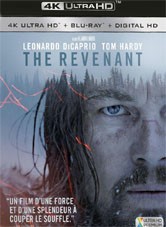The Revenant
Il y a deux « revenants » dans le dernier film d'Iñárritu : Leonardo DiCaprio bien sûr dans le rôle de Hugh Glass, ce trappeur laissé pour mort après l’attaque d’un ours et qui, pendant 2h40, va tout affronter pour survivre et surtout retrouver la trace de celui qui a assassiné son fils (Tom Hardy). Froid terrible, tempêtes, blessures, massacres, chutes d’eau et de neige, Glass constitue une sorte de Lazarre des glaces dont l’aventure s’inspire en grande partie de celle d’un aventurier blessé qui, en 1823, a parcouru plus de 300 km à pied dans le territoire des Indiens Dakota afin de rejoindre son fort d’origine.
Le second revenant, plus familier des cinéphiles, s’appelle Richard Sarafian, réalisateur encore un peu oublié d’une poignée de films d’importance réalisés dans les années 1970, dont Le fantôme de Cat Dancing et Vanishing Point (Point limite zéro en français), road‑movie terminal qu’on en finit plus de redécouvrir. En 1971, le scénariste Jack DeWitt s’empare de l’histoire de Glass et écrit Le convoi sauvage (Man in the Wilderness) que réalisera Sarafian. Celui‑ci apporte plusieurs modifications au script et introduit l’idée folle et géniale d’un bateau convoyé sur terre et d’une bande de trappeurs dont le capitaine, sorte de Achab des forêts convaincu que Glass (interprété par Richard Harris) le poursuit, est interprété par John Huston.
Trente ans plus tard, un certain Michael Pumke adapte à son tour le récit de Glass. Ainsi, The Revenant devient officiellement la source littéraire du film d’Iñárritu. Pourtant, durant le visionnage de The Revenant, le fantôme insistant du chef‑d’œuvre de Sarafian vient hanter tous les plans, au point qu’on finit par attendre le générique de fin pour vérifier qu’Iñárritu aura au moins eu l’élégance de citer celui auquel il a tout emprunté, ou presque, puisque les meilleures idées de DeWitt/Sarafian ont été supprimées (la dimension métaphysique de la trajectoire de Glass, l’inanité de la quête) et remplacées par une histoire de vengeance sans nuances. Or rien ne vient. Pas un mot. Sarafian, disparu en 2013, aurait apprécié. Comme Tarkovski, autre source « d’inspiration » manifeste du film (sur internet, une vidéo implacable circule où l’auteur met en évidence les nombreux « emprunts » d’Iñárritu au réalisateur de Stalker).
Que dire donc de ce film qui, entre plagiat inavoué et emphase creuse (on dirait par moments du Winding Refn), s’avance comme un mastodonte multi‑oscarisable accompagné d’un battage médiatique qui voudrait faire office de critique (tournage homérique, conditions climatiques extrêmes, performance hors normes de DiCaprio, exigences particulières du cinéaste…) ? Pas grand‑chose. Sinon qu’on aimerait bien faire du canyoning dans ces mêmes paysages du Canada mais aussi que les limites d’Iñárritu, reconduites de film en film, éclatent ici au grand jour : une caméra en mouvement constant qui ne trouve jamais sa juste place, un style amphigourique et mallickien qui confond la rumeur et la poésie, l’incapacité d’Iñárritu à accorder sa propension à l’épate visuelle à la moindre vision, ou encore son étrange conviction que le trentième plan de la cime des arbres rapprochera le film de la mystique. Seul Leo DiCaprio sait où il va, à Fort Kiowa.
Au fond, un petit survival qui, en dépit de son épaisse peau de bête, n’arrive pas à la cheville du Convoi sauvage, l’original, de Richard Sarafian.