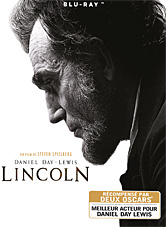Lincoln
Le rayon DVD d’un musée américain consacré à la gloire des présidents ou à l’histoire de l’esclavage : voici sans doute ce qui attend le dernier film de Steven Spielberg, sobrement intitulé Lincoln, un film « polemic proof », sans épines, impeccable, léché, historiquement rigoureux, joliment hagiographique, et flanqué d’un acteur‑sosie irréprochable qui n’a nécessité aucun effet spécial (Daniel Day‑Lewis).
Cela dit, Spielberg n’est ni le premier, ni le dernier à s’intéresser au seizième président des États‑Unis, celui à l’aune duquel tous les autres sont depuis jugés ‑John Ford, auquel Steven ne cesse de faire référence, lui a consacré deux films obliques (Je n’ai pas tué Lincoln en 1936 et trois ans plus tard, le génial Vers sa destinée, sur les premiers pas de l’avocat de Springfield), et Griffith en a tiré un biopic référence (Abraham Lincoln, 1930)‑.
Le récit se concentre cette fois sur les derniers mois de la seconde mandature de Lincoln (1863), lorsque le pays, en pleine guerre de Sécession, se déchire, notamment autour de la question sensible de l’esclavage : au Nord, l’Union et les sympathisants de son abolition, au Sud, les Confédérés et les défenseurs de son maintien. Père républicain de la Nation, adoré par une immense majorité d’Américains, Lincoln n’est pourtant politiquement qu’un colosse aux pieds d’argile. À la manière de Spencer Tracy dans Le soleil brille pour tout le monde, l’homme au chapeau haut de forme se lance dans ce qui sera le dernier et le plus symbolique de ses combats : faire voter au parlement le XIIIe amendement assurant l’abolition de l’esclavage.
La forme très mezzovoce de Lincoln pourra surprendre : hormis la séquence de bataille inaugurale, sorte de variation autour de celle du Soldat Ryan, le film se résume à une succession de débats en huis‑clos, à des ratiocinations hyper‑techniques entre députés des deux camps (les Démocrates sont, à cette époque, favorables à l’esclavage), sbires, conseillers et autres hommes influents, autant de discussions qui, pendant les trois premiers quarts d’heure, risquent de laisser bon nombre de spectateurs sur le carreau.
Car Spielberg prend son temps pour éclairer la double raison politique de Lincoln (sans esclavage, plus de raison pour les Sudistes de poursuivre la guerre) et éthique (sa conviction de l’égalité entre les Blancs et les Noirs) et fait œuvre de formidable pédagogue. Pour qui s’intéresse à cette période‑clé de l’histoire des États‑Unis, voici un film digne de figurer dans les manuels d’Histoire, aux côtés d’Amistad, qui fonctionne avec Lincoln comme un diptyque.
Mais, parce qu’avec Spielberg il y a toujours un « mais », le réalisateur filme, encore une fois, du point de vue rétrospectif d’une histoire mythique qui ne tolère aucune nuance (voir le traitement caricatural des pro‑esclavage) et de la légende de Lincoln. Souvent filmé en contre‑jour, collé à une source de lumière quasi divine, Lincoln ressemble à un Christ sculpté par Giacometti : l’homme ne parle pas, il voit et prêche, sorte de prophète qui ne manque jamais une occasion de délivrer sa parabole à une assistance médusée (et Dieu sait qu’il raconte des histoires, à la manière cryptée des évangiles), ce qui explique sans doute la mollesse du film, montrant combien, à chaque plan, l’Histoire lui donnera raison.
Plutôt que de clore son film sur le vote du fameux amendement, Spielberg choisit de le poursuivre jusqu’à l’assassinat d’Abraham le 15 avril 1865. Récemment, l’acteur Samuel Jackson reprochait à Spielberg de ne pas avoir terminé sur le plan de ce valet noir, tendant avec estime son chapeau au grand homme. Même si elle n’est pas dénuée d’arrière‑pensée (après tout Django, qui traitait lui aussi de l’esclavage, courrait aussi après les Oscars), la remarque est juste en ce qu’elle pointe, à savoir combien Lincoln, au fond, vise moins à éclairer un débat crucial (que des Noirs pré‑Obama et d’opérette dans le film) qu’à polir un peu plus l’immense statue de marbre blanc du Lincoln Memorial de Washington.