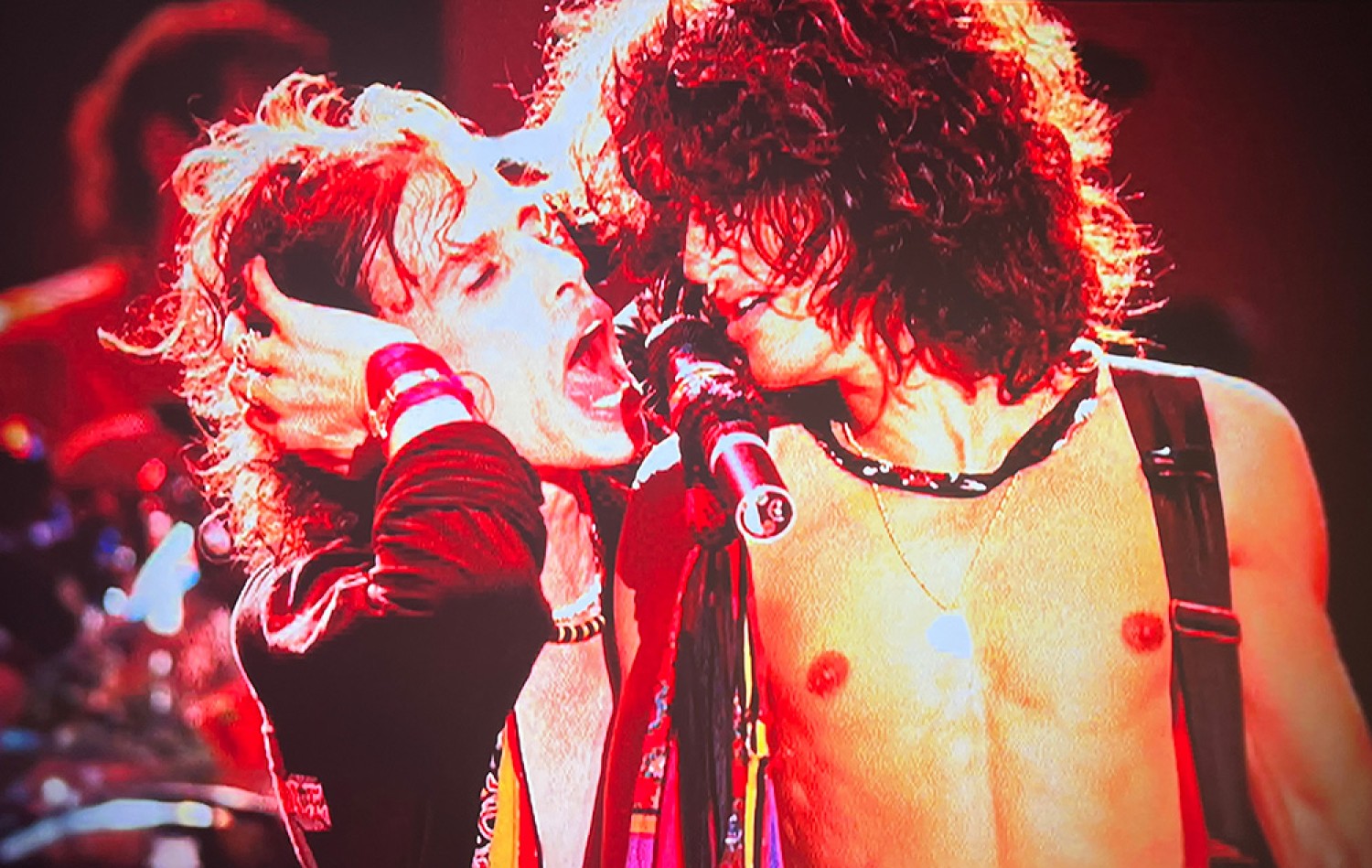38 témoins est adapté du roman de Didier Decoin Est‑ce ainsi que les femmes meurent ? Pourquoi cette adaptation et quelle a été votre manière de l’aborder ?
En fait, Yvan Attal m’a apporté le livre parce qu’il connaissait le fait divers. À sa sortie, il avait déjà envie de l’adapter. Mais il avait un autre projet en cours. Il m’a donc proposé de le faire... Je me suis surtout passionné pour la situation, effectivement, plutôt que d’essayer de donner une explication au geste de ces témoins qui n’ont rien fait (et qui, de mon point de vue en tout cas, est assez incompréhensible). Je me suis dit que jamais je ne trouverai une explication valable, et encore moins pour trente‑huit individus. J’ai donc préféré davantage m’intéresser aux conséquences sur eux ainsi que sur le reste de la société. Il s’agit d’une sorte de déplacement de point de vue.
Pourquoi avoir opté pour une ville portuaire telle que le Havre ?
J’ai choisi le Havre pas tellement pour le port, mais surtout pour l’architecture de la ville. L’architecture d’Auguste Perret au moment de la reconstruction, après les bombardements. En fait, il a reconstruit cette ville de façon extrêmement graphique, avec ces dragues, ces façades… Il en émane quelque chose de théâtral. Ensuite, l’idée du port est arrivée parce que cela apportait un rythme, une énergie particulière. Cela permettait également de donner des métiers singuliers à chacun des personnages, notamment pour celui d’Yvan Attal, que l’on ne connaît pas bien (il est pilote de port dans le film, NDLR). Voilà, c’était un peu comme avoir le beurre et l’argent du beurre.
Après votre collaboration dans Le ratp, quels ont été vos rapports avec votre acteur principal Yvan Attal ?
C’est forcément un rapport de confiance plus profond. On se découvre davantage, on peut se parler plus directement et essayer des choses plus radicales. On se comprend tout de suite, dans la mesure où il s’agit d’un projet qui commence. Il y avait une envie mutuelle de retravailler ensemble, et dès le départ, cela simplifie les choses. Ensuite, on revient à nouveau sur un partage professionnel, à travers lequel la complexité côtoie un travail en profondeur, qui nous permet d’aller plus loin à chaque fois.
On est saisi dans le film par ce cri terrifiant de la jeune fille assassinée, qui hante les nuits de Pierre. Ce cri ne métaphorise‑t‑il pas aussi un cri intérieur (en outre, la culpabilité qui le ronge et un secret qui pèse de plus en plus lourd) ? On pense à Christopher Cross dans Scarlett Street de Fritz Lang.
Oui, le cri est à la fois extrêmement concret et, de façon simultanée, il s’agit d’un cri langien qui le fait sursauter dans la nuit et le renvoie à sa culpabilité. Ce cri est imprimé à tout jamais dans sa mémoire, il s’agit aussi bien d’une métaphore que d’un événement extrêmement concret.
Après sa confession, Pierre se retrouve seul contre tous. Avez‑vous voulu montrer que, finalement, l’intégrité d’un seul homme n’est pas compatible avec l’amoralité de la société ?
Oui, c’est quelque chose d’assez commun. Parfois, le silence est plus confortable. Mais les choses tues peuvent être extrêmement néfastes dans la mesure où elles s’acheminent vers le refoulé. On les traîne ainsi de génération en génération, on n’y échappe donc jamais. De son côté, la parole met les choses brutalement en lumière, tout le monde peut en parler et émettre un avis. Le silence et le mensonge deviennent préférables dès lors que la menace du jugement et du regard extérieur se fait sentir. Pierre exprime sa propre confession avec celle des autres témoins, et d’une certaine façon, il dévoile un crime collectif. Il est donc deux fois coupable. Il brise la loi du silence et se met en dehors de la communauté. C’est le principe de base de tout clan ou de toute communauté un peu fermée et reliée à un secret.
Il y a deux histoires dans 38 témoins, une histoire d’amour en état de crise face au comportement de Pierre et une histoire de meurtre, soit une affaire publique qui finit par contaminer une affaire privée. Pourquoi cette connexion (non sans conséquences) entre les deux ?
Je crois que le général et le privé sont toujours intimement liés. Ça n’existe pas des couples qui sont à ce point fermés sur eux‑mêmes ou alors ce sont des couples très malades… Donc, l’intime est toujours contaminé, ou en tout cas traversé par le public. On ne vit pas en dehors du monde, ici, c’est probablement la peur du public qui fait exploser le couple. Louise essaie de sauver son amour justement en faisant en sorte que la faute de Pierre ne jaillisse pas, car autrement, elle ne pourra assumer son amour ouvertement. Tant que cela reste entre eux, elle peut s’arranger de tout. Comment peut‑on s’arranger individuellement ? Comment l’individuel et le privé peuvent résister à la pression extérieure ? Comment l’extérieur va mettre en évidence les fêlures du couple ? Le film pose ces interrogations…
Pourquoi cette sensation d’apesanteur tout au long du film ?
Parce qu’on est dans une situation post-traumatique. Tout le monde est en suspens et attend que les choses soient révélées. Oui, « en apesanteur », c’est pas mal, un état de déséquilibre…
La fin du film débouche sur une impasse, car l’enquête repart à zéro et Pierre, abandonné par sa compagne, se retrouve encore plus seul qu’il ne l’était. Pourquoi ?
Non, ce n’est pas une impasse parce que la société va prendre en charge les faits. Il y aura jugement et restriction commune. Cependant, la société ou la communauté ne peut pas prendre en charge les problèmes individuels, chacun fait avec sa conscience et avec ce qu’il est. Cette faute le pèsera toute sa vie. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une impasse, cela concerne la responsabilité individuelle. Comment chacun fait avec ses actes ? Comment vit‑on avec cela à partir du moment où on est maître de son libre‑arbitre (même si celui-ci peut être est altéré par cet effet de sidération) ? On est tout de même en mesure d’assumer ses actes, de se responsabiliser, avec un minimum d’honnêteté. C’est la raison pour laquelle la faute de Pierre est lourde à porter, il n’a pas fait ce qu’il fallait faire et cela le poursuivra toujours. Maintenant, avec une bonne psychanalyse, on vit avec… (rires).
On sent aussi l’influence de John Ford et Fritz Lang. L’œuvre de ces cinéastes constitue-t-elle l’une de vos sources d’inspiration ?
Oui, bien sûr. Je n’y pense pas à chaque fois que j’écris mais je vois bien d’où ça vient, ce sont des films que j’ai vus et revus enfant. Ce sont des cinéastes politiques, moraux et humanistes que j’admire beaucoup, leurs thèmes restent d’actualité. Le John Ford des années 30, 40, 50 est encore juste aujourd’hui. De même pour Fritz Lang. De nos jours, il y a des cinéastes importants qui sont moins d’actualité, ce qu’ils racontent, ou l’orientation morale, peuvent être remis en question avec le recul historique, etc. Au contraire de Fritz Lang, M le Maudit est emblématique d’un film qu’on ne pourrait plus faire aujourd’hui ou difficilement. Il s’agit tout de même d’un assassin d’enfants, or, il n’est pas envisagé comme un monstre absolu. C’est un film qui pose énormément de questions, autant sur la société que sur l’individu. Si on reprend Furie, qui est un film américain de Fritz Lang plus tardif, on peut constater que rien n’a changé sur le fond. Les propos restent authentiques et le film est toujours dérangeant, révolutionnaire et complexe, alors qu’il a une soixantaine d’années. C’est également le cas avec John Ford, parce qu’il sonde les profondeurs de l’âme humaine, tout en la rattachant à des valeurs communes et homogènes. Plus on creuse en profondeur, plus on se ressemble. Les questions de société et humaines, en l’occurrence, se bousculent : comment la justice s’incarne-t-elle ? Comment la pratique-t-on ? Comment la société, la démocratie se définissent elles et sont elles envisagées en dehors du fantasme et du mythe ? Quand on prend L’homme qui tua Liberty Valance, c’est un film sur la démocratie et la justice d’une modernité absolue. C’est incroyable à quel point ce film regorge de complexité, autant à travers ses thématiques que ses personnages. Pourtant, c’est un film grand public, populaire, c’est en ce sens que John Ford et Fritz Lang sont des cinéastes gigantesques.
38 témoins a‑t‑il été un projet facile à monter, financièrement parlant ?
Oui, ça s’est monté assez facilement. D’une part, ce n’est pas un film extrêmement cher et d’autre part, il y avait Yvan et Nicole Garcia également…
Votre prochain projet ?
C’est moins noir. Il s’agit d’une adaptation de Philippe Vilain qui s’appelle Pas son genre, une histoire d’amour compliquée et désespérée entre un philosophe et une coiffeuse.