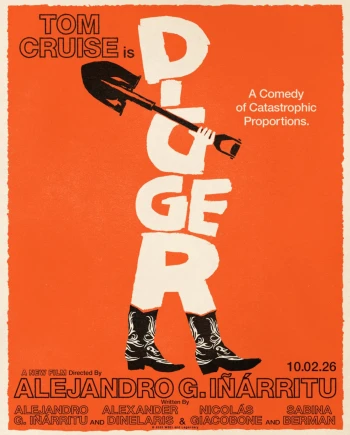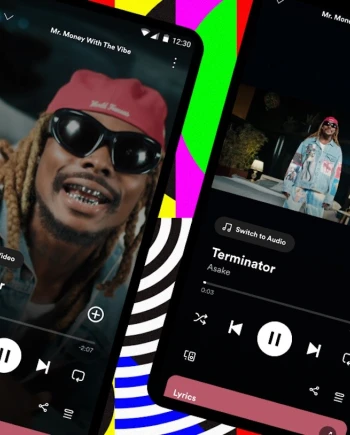D'où vient l'idée du film ? L’envie de travailler avec Roschdy Zem ou celle de revenir au film d'action ?
C'est plus compliqué que cela. En fait, c'est un producteur qui est venu me voir et m'a proposé de refaire un film d'action. Je n’étais pas emballé car j’en avais déjà pas mal fait et j’aime bien faire des choses différentes. Et puis, il m'a parlé de Roschdy Zem et ça faisait longtemps que j’avais envie de travailler avec lui. J’ai essayé de penser à un film pour lui et tout d'un coup, je me suis souvenu d'un fait divers et ça s'est déclenché…
Qu’a‑t‑il de particulier à vos yeux ?
Pour moi, quand je fais un film d'action, j’essaie le plus possible de raconter une histoire de façon visuelle et ne pas m’appuyer sur la béquille du dialogue. Parce qu’à mon sens, un héros de film d'action, par définition, c’est par l'action qu'il existe et qu'il se révèle. Roschdy a ce charisme‑là. Celui qu’ont des acteurs comme Lino Ventura ou Steve McQueen : ils n'ont pas besoin de mots pour exprimer ou faire ressentir. Ils ont un charisme, une sensibilité que l'on perçoit directement. Ce qui n’est pas donné à tout le monde.
Sans vouloir dénigrer le film, on peut dire que l’histoire n’est pas vraiment originale…
Effectivement, c’est l’histoire classique d’un adulte qui protège un enfant et qui va en être transformé. Un postulat de départ, vieux comme l’histoire du cinéma. Un peu comme Le vieil homme et l’enfant, Léon ou Man on Fire, version Tony Scott ou Élie Chouraqui, ou même de Gloria de Cassavetes. Il y a beaucoup d’influences dans mon film. Je ne le cache pas. C'est un film qui s'inscrit totalement dans une tradition de cinéma, celle avec une figure paternelle brisée.
Mais avec cette notion paranoïaque en plus…
Oui, l’idée était de construire un personnage complexe mais aussi de parler du syndrome post‑traumatique de quelqu'un qui a vécu une expérience terrible en Afghanistan. J’avais envie de travailler sur cette paranoïa. Au début du film, je présente Elyas (Roschdy Zem) au spectateur comme ayant un problème psychologique, mais un problème assez flou. Plus tard, quand on arrive dans le château, le spectateur sait donc qu'il a un problème, et à partir de là, tout est possible ! C'est là que le film devient véritablement un thriller. C’est‑à‑dire qu'à un moment, on ne sait plus non seulement ce qui va se passer, mais aussi où est la réalité…
Cela fait longtemps que vous n’aviez pas réalisé de film d’action. Diriez‑vous que le genre a évolué ?
Non, je n'ai pas le sentiment que le genre a vraiment évolué, mais les effets spéciaux, oui. Cela a modifié la façon de raconter les histoires. Souvent, maintenant, les scènes d’action sont filmées en plan‑séquence, parce que c'est une forme de virtuosité. Mais c’est lié aux effets spéciaux, pas au genre en tant que tel. D'ailleurs, on le voit bien avec les films de super‑héros, ce n'est que de la virtuosité avec des effets spéciaux. Moi, je suis plus dans une tradition où le personnage fait évoluer l’histoire et l'action révèle le personnage.
Cela influence votre manière de filmer les scènes d’action ?
À chaque fois, dans les scènes d'action que je tourne, c'est cet axe‑là qui m'intéresse. Par exemple, dans la première scène d’action du film qui dure 5‑6 minutes et se situe dans le château, c'est le moment où on réactive Elyas en mode : « Je sais pratiquer la violence et je sais m'en servir ». La seconde, c'est la scène dans le camping‑car. Tout à coup, on est dans l'espace mental d’Elyas, à l'intérieur de sa tête : il va tuer ses fantômes, le trauma qu'il poursuit et qui l’empêche de vivre. Enfin, la dernière scène, c'est 20 minutes d'action pure, dans la tour. Dans le film, l’action va donc crescendo, contrairement à ce qui se fait souvent dans le cinéma américain où on commence souvent par une scène d’action pour capter tout de suite l’attention du spectateur.