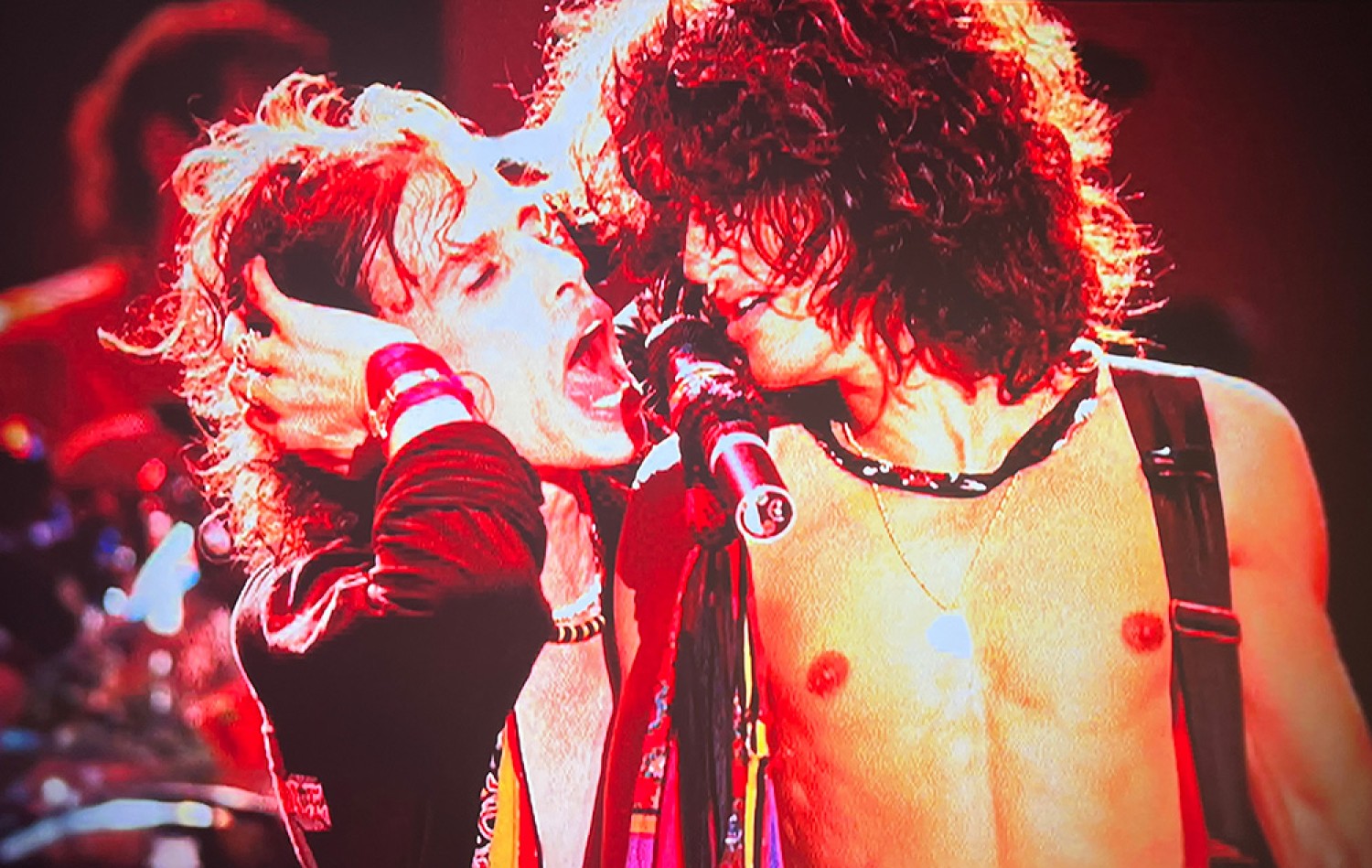Wall Street 2, l'argent ne dort jamais
On peut voir et revoir Wall Street d’Oliver Stone, le premier volet, comme un formidable document sur l’Amérique, et donc le monde, des années 1980. La décennie des brushings et de Reagan, de George Michael et de l’aérobic, du sourire carnassier de Larry Hagman dans la série Dallas et de l’arrogance clinquante d’une nouvelle race de winners qu’on appelait alors les « yuppies ».
Réalisé en 1987 juste après Platoon et un an avant le krach boursier, Wall Street ajoutait une nouvelle figure au panthéon des bad guys fascinants du cinéma hollywoodien : Gordon Gekko (Michael Douglas), trader impitoyable aux cheveux lissés, amateur d’aphorismes tranchants (« Si tu veux un ami, prends‑toi un chien »), esthète raffiné et beau parleur brillant en regard duquel les héros humanistes du cinéma américain passaient alors pour des individus ternes et moralisateurs, mous et privés d’éclat.
Comme Tony Montana (Scarface), son alter ego mafieux devenu lui aussi une matrice contemporaine, Gekko incarnait toute une série de valeurs (l’obsession de la réussite, l’individualisme forcené, le mépris des faibles et des idiots) auquel le monde a finalement donné raison. En faisant de Gekko une icône instantanée, les traders de Wall Street ne s’y sont d’ailleurs pas trompés. Cette méprise a, paraît‑il, toujours chiffonné Oliver Stone qui, vingt‑deux ans plus tard, a décidé de remettre Gekko dans le jeu des finances d’aujourd’hui ‑post‑crise, post‑Lehman and Brothers, etc.‑, et de remettre enfin les points sur les « i ».
Après huit ans passés derrière les barreaux, Gekko sort donc de prison, mal rasé, sans le sou, flanqué d’un portable d’époque genre talkie‑walkie. Une limousine s’approche, il croît que c’est pour lui. Fausse piste, un rappeur gangsta s’y engouffre. Raccourci formidable et meilleure idée du film. Pour le reste, Stone se débat pendant 130 longues minutes avec un scénario invertébré, répétitif, jargonneux (« shortage », « hedge funds », « aléa mora ») et truffé de sous‑intrigues avortées.
À droite, Gekko tente donc de remonter la pente des affaires et de regagner le cœur d’une fille à dormir debout (Carey Muligan, plus jamais ça), fiancée à un jeune trader écolo‑idéaliste (Shia LeBeouf) qui reprend péniblement la ligne tracée par Charlie Sheen en 1987. À gauche, des banques d’investissements qui s’effondrent, des OPA sauvages filmées de façon poussive et des requins cyniques qui exigent de la FED, et donc des contribuables, qu’elle éponge leurs dettes. Scandale !
On pensait que la crise financière de 2009 allait permettre à Oliver Stone d’actualiser sa critique du système financier, mais ce qui percutait hier (« l’avidité, c’est bien ») appartient aujourd’hui au bréviaire consensuel du commentaire médiatico‑politique. « La spéculation est la mère de tous les maux » peut alors lancer l’ex‑gourou des affaires devant un parterre médusé d’apprentis traders et de spectateurs assoupis par un anti‑capitalisme devenu lot commun. On est tous d’accord.
Et Gekko dans tout ça ? Hormis une séquence finale qui fleure bon la greffe de circonstance (Gekko attendri par la vision échographique de son futur petit‑fils, grotesque), l’homme redevient ce qu’il a toujours été, cynique, manipulateur, éclatant, et c’est tant mieux. Reste Michael Douglas, toujours aussi bon, point d’ancrage et d’attraction du film.