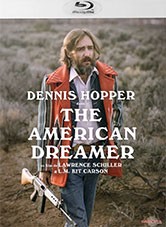Il est des films qui font fantasmer la fin des années 60 comme une période de liberté et de protestations fiévreuses, où tout était à réinventer, où la révolution était sur toutes les lèvres, où une génération brisait tous les tabous pour imaginer une autre société : Taking Off, Zabriskie Point, Easy Rider. Et puis il y a des films comme The American Dreamer qui laissent un goût dérangeant tant ils montrent la naïveté et les égarements de cette période, les réduisant à un spectacle pathétique et pénible, boursouflé par les élucubrations de Hippies qui déblatèrent des inepties.
Un rêveur à la hauteur ?
Nous sommes en 1970 et Dennis Hopper a carte blanche. Son premier film, Easy Rider, a été un succès fulgurant aux États‑Unis et Universal Picture a donné au jeune réalisateur un million de dollars pour son prochain projet, The Last Movie. Le résultat sera une expérimentation très controversée (aujourd’hui devenue culte, naturellement) autour du cinéma et de la création que le réalisateur aura toutes les peines du monde à finir, tant et si bien qu’on l’accusera même d’avoir voulu s’auto‑saboter en post‑production.
C’est justement pendant le montage de The Last Movie que deux réalisateurs (Lawrence Schiller et L.M Kit Carson) décident de filmer Dennis Hopper dans sa cabane perdue au milieu du désert américain. Sans vraiment de plan, l’idée est de créer spontanément un documentaire autour de la figure rebelle et iconoclaste qu’est devenu Dennis Hopper auprès de la jeunesse cinéphile américaine, de le filmer pour ce qu’il est devenu : un porte‑parole, un génie controversé et fascinant, ce fameux « rêveur américain » qui saurait inventer un nouveau langage à la hauteur d’une génération prête à rêver.
Un doc sans direction
Mais ça, c’est sur le papier. Parce qu’en réalité, The American Dreamer est une source d’embarras sans fond, un documentaire dépourvu de tout intérêt, naviguant sans direction, qui présente Dennis Hopper de la pire façon : un type complètement défoncé, paranoïaque, déjà perdu au cœur de son propre mythe, s’écoutant ergoter pendant des heures. Malgré sa courte durée de 80 minutes, le documentaire est une interminable purge qui ne fait que réduire en bouillie le mythe Hopper.
Celui‑ci ne semble pas quoi faire avec cette caméra posée devant lui. Il prend la posture d’une sorte de gourou hippie qui, les yeux dans le vague, a besoin de dix secondes de réflexion avant de sortir des aphorismes du genre : « Je ne vois pas comment on peut croire en l’évolution… sans croire en la révolution… ». Les mots‑clés du moment sont là, mais jetés en vrac, en espérant qu’un air sérieux et pensif saura épaissir les phrases les plus creuses. Éteint, paumé, Hopper dégage une aura de pur looser, voire montre toute sa toxicité. Dans une séquence révélatrice, Hopper discute avec une modèle de Playboy, tout fier de lui à dire « Au fond, je dois être lesbienne » parce qu’il préfère donner du plaisir à ses conquêtes. Atterrée, la modèle lui répond que non, il fait juste plus attention à ses partenaires et que c’est tout à son honneur. Mais trop heureux de son bon mot, Hopper la coupe, répète sa phrase toute faite avec jubilation. Et quand la modèle semble vouloir amener la conversation plus loin, le montage décide de passer à autre chose, effaçant cette voix féminine pour laisser plus de place à la vacuité masculine.
Un parti pris gênant
Car malgré la stupidité affichée de Hopper, ce n’est pas lui qui agace le plus tout au long de The American Dreamer, mais bien le duo de réalisateurs : leur incompétence évidente, leurs penchants voyeuristes glauques, mais surtout leur effroyable complaisance. Ils sont venus filmer le prophète lunaire et se fichent du reste, imaginant que le cinéma direct se résume à être affreusement intrusif avec son sujet. Le documentaire regorge de purs moments de gêne, où Hopper lui‑même indique aux réalisateurs qu’il n’aime pas leurs méthodes, leur façon de lui demander de répéter ses phrases et de rendre le moindre échange artificiel, notant que rien de ce qu'ils ont pu filmer n'a été honnête ou « vrai ».
Faire l’amour avec Hopper dans une baignoire ?
Bien sûr, il y a une satisfaction secrète chez Hopper d’être l’objet de tant d’attention. Mais il y a aussi un malaise profond qui émane de tout le film, en faisant une expérience pénible au possible. À un moment, au début du tournage, un Hopper complètement à l’ouest raconte à la caméra que son rêve serait de vivre pendant six mois en isolation avec trois femmes qui le laverait et lui ferait l’amour. Qu’à cela ne tienne, les réalisateurs décident d’inviter une vingtaine de jeunes femmes et de filmer tout ça. On voit donc ce petit harem épuisé de gamines paumées débarquer chez l’ogre Hopper dans tout le dernier tiers du film, interminable et glaçant, où elles sont entassées sur un lit face à un Hopper incapable de jouer les gourous. Pire, les réalisateurs trouvent deux filles qui acceptent de se laisser filmer en train de le laver et de faire l’amour avec lui dans une baignoire. Le film nous montre tout cela, mais pourquoi faire ? La fascination est nulle. Le dégoût immense.
Mythologie du vide
Voilà l’avant‑garde « magnifique » de la contre‑culture, tout juste bonne à exploiter des femmes pour sa propre mythologie vide. Trois minutes plus tard, Hopper est en cuir, en train de tirer à la mitraillette sur des cibles de carton dans la pampa. Avec des idoles pareilles, pas étonnant que personne n’ait réussi à changer le monde. Révoltant et pathétique, The Americain Dreamer a cela d’intéressant qu’il réussit malgré lui à éteindre ce qu’il pouvait rester de fascination pour ces Sixties tant vénérées. Une gueule de bois qui donne au moins envie d’aller voir ailleurs et de laisser le passé pourrir tout seul.