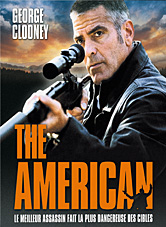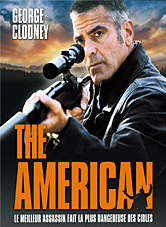The American
Il existe sans doute deux façons, pour Hollywood, d’investir un pays : en le pliant à ses règles de jeu, au risque de le priver de ses particularismes (Paris dans Ronin de John Frankenheimer ou La mémoire dans la peau, simple théâtre d’une action qui aurait pu se dérouler à Boston ou Chicago), ou bien, et c’est le cas de The American, en se laissant pénétrer par le rythme, les couleurs et la géographie du susdit pays.
Photographe, clipeur et directeur artistique pour U2 et Depeche Mode, Anton Corbjin signe ici son deuxième film en posant sa caméra et George Clooney au cœur des Abruzzes, dans un petit village italien dont on aurait vidé les rues et les espaces. Après avoir tué la femme qu’il aimait, Jack, un tueur à gages vieillissant, est contraint de se mettre au vert, direction l’Italie. Un dernier contrat, la certitude d’une menace qui se rapproche, une call‑girl dont il ne faut pas tomber amoureux (Violante Placido, unique manifestation charnelle dans un monde proche de la glaciation et qui débute, forcément, dans les paysages enneigés de Suède), et un prêtre philosophe (Paolo Bonaccelli, Gemini un brin convenu de George).
Étrange et antipathique entrée en matière pour Clooney que le récit, au fond, ne rééquilibrera jamais et qui explique pour partie l’échec cuisant du film aux États-Unis. Sous les auspices avoués de Sergio Leone (un extrait d’Il était une fois dans l’Ouest vient même éclairer la parenté fantasmée du cinéaste à l’un de ses modèles) et surtout de Melville, tant Clooney ressemble à une version vieillie du Samouraï (même mutisme, même mélancolie chevillée au corps, même pacte scellé avec la mort, même professionnalisme hanté par le vide), The American prend à rebours l’épileptisme des thrillers hollywoodiens post‑Bourne et s’installe dans une torpeur somnambulique qui laisse peu de grain à moudre aux amateurs de poursuites et de gunfights explosifs.
Héros d’apparence leonienne, Jack arrive dans ce village tel l’étranger Eastwood, mais ne redistribue pas les cartes du récit, ne provoque aucun mouvement. Corbjin, grâce à une mise en scène épurée et une photographie saturée, utilise à merveille la dimension sépulcrale des lieux, expédie tous les moments d’accélération (et de révélation) et vise le point mort de l’action, ce point que Melville, à la fin de sa carrière, rêvait lui aussi d’atteindre. Clooney lui‑même, aux antipodes du charmeur pétillant de In the Air, se glisse parfaitement dans la peau de cet homme taciturne, incapable d’éprouver une réelle passion, presque nihiliste : « Tous les hommes sont des pêcheurs », avoue‑t‑il au milieu du film, en écho tardif à une réplique similaire (« Tous les hommes sont coupables ») du Cercle rouge.
Pari risqué donc, qui possède aussi son envers puisque le film, visuellement irréprochable, peine à transformer la passivité de son personnage (ou sa manière d’agir sous la contrainte), en petite métaphysique du monde.