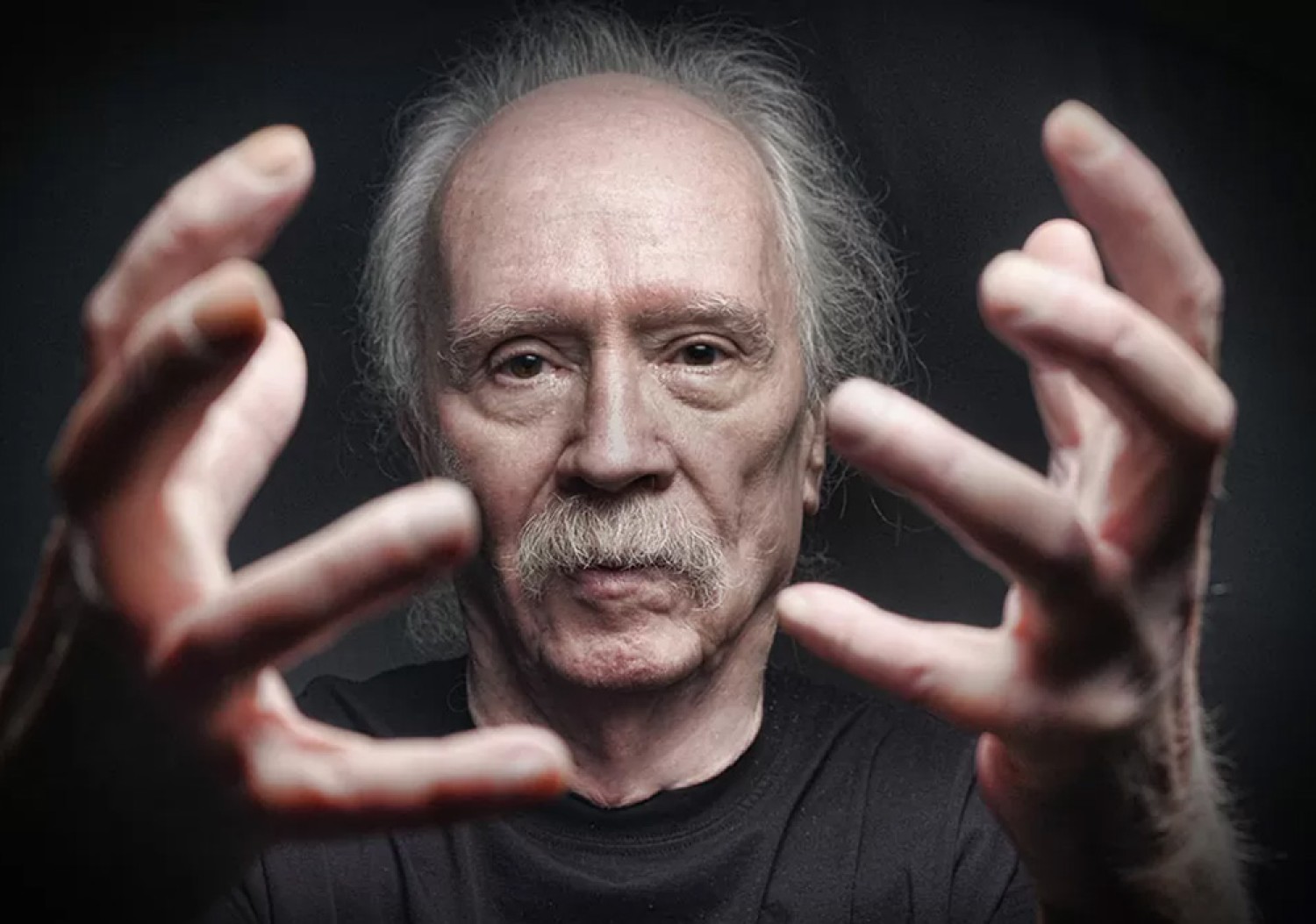Public Enemies
L’histoire de Public Enemies, inspirée d’un livre somme de Bryan Currough, était taillée aux mesures du réalisateur de Heat : Michael Mann. Soit celle de Dillinger (Johnny Depp), l’ennemi public numéro 1 des années 1930, versus Mevin Purgis (Christian Bale), sa némésis et bras armé d'Edgar Hoover qui, au sein du FBI, crée alors une élite d’agents spécialisés dans la lutte contre le crime, les G-Men. Treize mois de traque tendue et sanglante qui s’achèveront en 1934 devant le Biograph Theater de Chicago, projetant alors le film miroir de la courte vie de Dillinger (Manhattan Melodrama avec Clark Gable et Myrna Loy).
Johnny Depp succède ici à Laurence Tierney et Warren Oates, deux interprétations de Dillinger, l’une pâle (Dillinger de Max Nosseck en 1945), l’autre goguenarde et énergique dans la très bonne version de John Milius en 1973, dont Public Enemies constitue, à bien des égards, le remake.
Calme et solitaire, incorruptible et charmeur, Depp reprend (plutôt bien) le flambeau de ces héros manniens (De Niro dans Heat, Cruise dans Collateral), hyper-compétents, obsessionnels et mélancoliques qui, même à l’orée de la chute, ne cèdent jamais à la furia, à la violence anarchique et incontrôlée. De ce point de vue, le Dillinger de Depp évoque plus le samouraï existentiel de Melville que James Cagney chez Walsh (L’enfer est à lui) : aucune saute d’humeur, aucune exubérance, mais une élégance cool et raffinée dont il ne se départira jamais.
Sans remonter aux classiques du genre (Public Ennemi, White Heat, Little Caesar), souvenons-nous seulement de Bonnie and Clyde en 1967, et de la façon dont Penn avait réussi à faire vibrer autour du couple Beatty/Dunaway une époque (la Grande Dépression des années 1930) et l’atmosphère de l’Amérique contestataire de la fin des Sixties.
Ici, Mann reste tellement concentré sur ses deux personnages (les autres membres de la bande, Baby Face Nelson, Van Meter, Floyd, sont à peine esquissés), et sur ce qui leur arrive ici et maintenant (beauté de la HD et sentiment d’une actualité immédiate des événements évacuant toute forme de nostalgie), déploie une telle méticulosité dans la reconstitution des lieux (le pénitencier de l’Indiana duquel Dillinger s’évade dans la séquence d’ouverture, le Little Bohemina Lodge où débutent la débâcle de sa bande et une fusillade nocturne visuellement somptueuse), que son film manque parfois d’ampleur, de lyrisme.
Il ne s’agit pas d’une question de scénariste (écrire la scène qui parlera de ce qui se passe à côté), mais de la capacité à charger l’air et le cadre d’un ailleurs qui les hante. D’ailleurs, pour la première fois depuis La forteresse noire en 1983, Mann ne filme pas son plan fétiche, celui d’un personnage décadré, perdu dans la contemplation mélancolique d’un horizon impossible à atteindre.
L’étrangeté de Public Enemies, ou plutôt la difficulté à le situer dans la filmographie de Mann, réside dans le fait qu’on y retrouve intacts tous les thèmes du réalisateur de Miami Vice (le dernier coup, le passage du crime artisanal à son industrialisation, la disparition des codes d’honneur contre la froideur des corporate), sa configuration favorite (deux professionnels dont les trajectoires finissent par se recouper), son goût pour l’abstraction, et même une piste nouvelle qu’il traite de façon admirable : la conscience qu’acquiert Dillinger de devenir en temps réel une icône de cinéma.
Comme tous les polars de Mann, Public Enemies est une tragédie mais filmée comme une folk song (Ten Million Slaves d'Otis Taylor pour l’introduction blues de Purvis, et cette idée géniale de relier la chasse des gangsters à celles des esclaves), là où le Solitaire, Heat ou Miami Vice ressemblaient plutôt à des opéras contemplatifs.