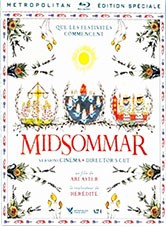Midsommar
Dévastée par une tragédie familiale, Dani (Florence Pugh, The Little Drummer Girl) accepte de suivre son petit ami Christian (Jack Reynor) ‑qui était sur le point de la quitter‑ et ses amis en Suède pour un festival estival au folklore coloré. Mais sous le soleil de minuit, le monde s'inverse…
Un an après Hérédité (2018), le réalisateur et scénariste américain Ari Aster revient avec un second long métrage qui confirme les espoirs placés en lui. Et, à nouveau, glisse un drame personnel (ici familial et amoureux) dans une proposition inédite de cinéma d'horreur dépouillée de ses effets traditionnels.
Midsommar (mi‑été en suédois) est un éclatement total. Éclatement de la rétine, d'abord, car ici, tout est baigné de lumière, en permanence (on préférera d'ailleurs la version cinéma au Director's Cut, où vient notamment s'ajouter une scène nocturne qui brise le règne du soleil et l'unité stylistique). Après un prologue tragique dans la nuit noire et froide américaine, rupture de ton : voilà une Suède pastorale, isolée du monde, jonchée de fleurs d'or, plongée dans un jour sans fin, où les gens, extatiques, virevoltent en habits blancs. Rien n'est dissimulé, sauf, parfois, ce qui se trame hors champ. Le cadre est large, le temps est long, aucune ombre ne vient cacher la réalité. Là est la surprise, tout se joue comme annoncé, comme suspecté, comme un enchaînement implacable.
Éclatement des codes, ensuite. Car au‑delà de l'expérience sensorielle, c'est notre perception du monde qui s'en trouve bouleversée. En plongeant un échantillon de société dysfonctionnelle (le groupe « d'amis ») au cœur d'une communauté évoluant en harmonie, Ari Aster nous interroge sans jamais nous permettre de réellement choisir notre camp. Quel regard portons‑nous sur ces rites perçus comme des abominations mais qui permettent pourtant de sauvegarder l'unité d'un groupe d'êtres humains vivant en symbiose, comme les cellules d'un même organisme, tandis qu'en face, les jeunes Américains n'ont de cesse de privilégier l'individu au détriment du tout. Quitte à mettre en péril leur modèle de société. On pourra d'ailleurs reprocher l'utilisation archétypale des personnages américains, chacun incarnant peu ou prou un péché : le mensonge, l'hypocrisie, l'égoïsme, la malhonnêteté intellectuelle, l'insensibilité, l'indifférence.
Un emploi heureusement compensé par l'ajout de quelques personnages secondaires plus équilibrés dans leur « normalité » et surtout de Dani, jeune femme incarnant la bonté naïve, la délicatesse, mais aussi le manque d'estime de soi. Visage lunaire, Florence Pugh, révélée dans The Young Lady (2017), brille ici en âme éteinte, qui va éclore dans ce bain de jouvence païen, cruel par nature, impitoyable mais sans noirs desseins.
C'est là que l'on trouve dans Midsommar d'autres choses que dans le classique The Wicker Man (1973), influence évidente, d'un point de vue situationnel tout du moins. Car ici, la secte, aux rites tour à tour hypnotiques, logiques, gracieux, atroces, joyeux ou grotesques, libère l'héroïne de son deuil, mais aussi de son emprisonnement mental, tout en l'enfermant dans d'autres codes. N'y aurait‑il aucun espoir d'affranchissement au sein du monde des hommes ? Ari Aster, anthropologue, nous pose la question. Mais surtout, nous organise une mémorable fête païenne.