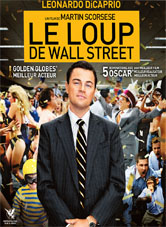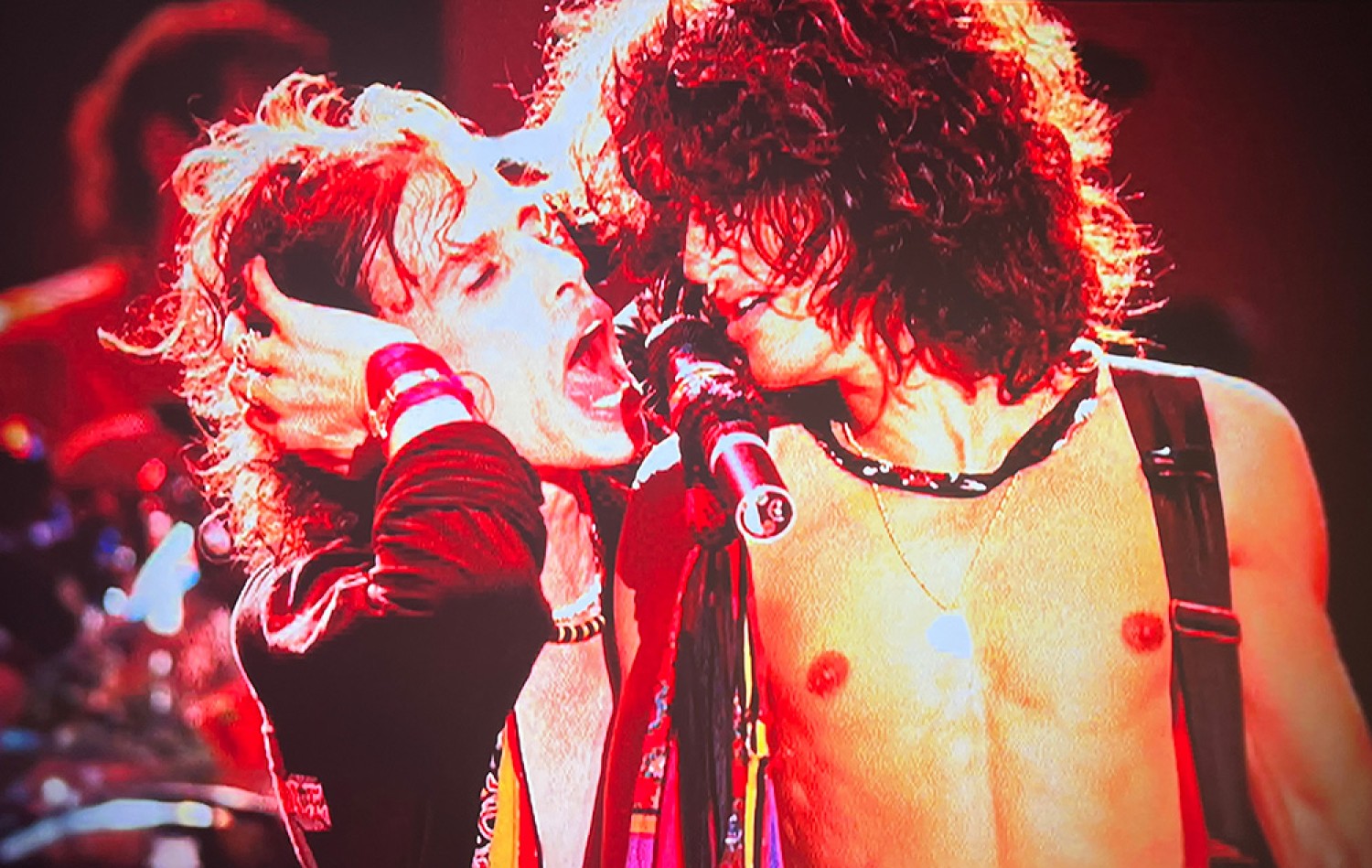Le loup de Wall Street
Contrairement à ce que pourrait laisser entendre son titre ‑Le loup de Wall Street‑ le dernier film de Martin Scorsese ne s’intéresse que de très loin au monde de la finance, à ses arcanes, à sa folie. À plusieurs reprises, Leonardo DiCaprio, qui interprète le rôle du tycoon Jordan Belfort, se lance dans une explication technique complexe puis semble se raviser, s’adresse à la caméra et, ses yeux plantés dans ceux du spectateur, explique que le jargon et les mécanismes économiques ont peu d’importance en soi, ce qui compte, c’est de savoir qui s’est enrichi et qui a piqué du nez.
Aux antipodes des fictions capitalisco‑critiques d’Oliver Stone (Wall Street 1&2 bien sûr) ou du récent Margin Call (consacré à la chute de Lehmann & Brothers) qui cherchaient à comprendre comment un système économique se dérègle, Le loup de Wall Street repart illico dans l’enclos des personnages scorsesiens, tous addict à une drogue (ici l’argent, et donc le pouvoir) qui leur procure un immense sentiment de puissance mais finit par causer leur perte. De ce point de vue, peu ou pas de différences de fond entre Belfort, Howard Hughes (Aviator) et Ace Rothstein (Casino).
Le film décrit en trois heures pile les débuts, l’apogée et la dégringolade d’un courtier new‑yorkais qui, à la fin des années 1980, va gravir les échelons du succès et de la fortune à une vitesse météorique, au point d’être surnommé « le loup de Wall Street ». Sexe, drogue, femmes et de l’argent comme s’il en pleuvait, la vie de Belfort n’est que débauche, excès et cynisme.
Sur le papier, tout était réuni pour que Scorsese retrouve enfin le niveau de Casino, son dernier grand film, réalisé en 1995. Or, entre les deux films, tout ressemble (la trajectoire du personnage, la démesure, les salles de marché filmées comme des salles de jeu, les vieux potes et les coups durs), mais tout dissemble : à la virtuosité stylistique de Casino, Le loup de Wall Street répond par une excitation d’une étonnante platitude formelle ; la puissance baroque a laissé place à une littéralité qui frôle souvent la vulgarité (soit une esthétique que Scorsese, à la différence d’Oliver Stone, ne sait pas manier). Enfin, du lyrisme et des envolées mélo de Casino (rencontre dans le désert sur fond de Mépris, mort de Joe Pesci…) ne reste que des saynètes bruyantes et privées de souffle. Tout comme les scènes de ménage qui, en dépit du talent des acteurs, semblent sorties d’une sitcom.
Au fond, Le loup de Wall Street, c’est Casino passé à la moulinette fadasse de la petite forme télévisuelle. Rien d’étonnant à cela lorsqu’on constate que le scénariste du film n’est autre que Terence Winter, auteur star des Sopranos et de Boardwalk Empire.
Comme dans toute bonne série télé, la mise en scène court après le scénario et ‑un comble pour un film de trois heures‑ n’a jamais l’occasion de prendre le pas sur le récit, de le ralentir (à l’exception d’une séquence d’hallucination très slow burn qui retrouve l’esprit d’un Blake Edwards), d’imposer sa loi ou sa durée.
Comme emporté dans un tourbillon d’événements sur lequel il aurait manqué de prise, Scorsese choisit, à la toute fin, d’abandonner son agité du bocal, pour cadrer, mais trop tard, le contrechamp de son film : après 170 minutes d’indécence, nous avons droit à une minute dans une rame de métro remplie de travailleurs modestes et fatigués. Un retour de bonne conscience que l’on pourrait même juger obscène.