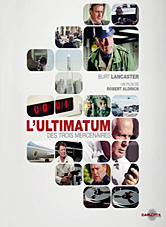L'ultimatum des trois mercenaires
Le cinéma de Robert Aldrich (30 films en 48 ans de carrière) est un cinéma de la crise qui, dès ses débuts ‑souvenez‑vous du coup de tonnerre que représentèrent pour la critique française les sorties rapprochées de Vera Cruz, En quatrième vitesse et Le grand couteau au milieu des années 1950‑, a eu la prescience de quelques‑unes des mutations formelles et narratives qui allaient occuper l’essentiel du cinéma post‑classique : la fin de l’accord réalisé entre l’individu et le monde, le brouillage des frontières morales et sexuelles, la spectacularisation des rapports de force (Plein la gueule, titre français de The Longest Yard qu’il réalise en 1974, sied parfaitement à son esthétique coup de poing), le mélange incongru des genres (Qu’est‑il arrivé à Baby Jane ?, mélodrame gothique et gore), et la violence des conflits, sa grande marque stylistique bien sûr, solution par défaut d’une énergie explosive impossible à contenir. Que faire de cette violence rentrée qui ronge les individus aldrichiens ? Comment la dépenser ?
Le héros aldrichien est un individu bigger than life survivant dans un monde rétréci, un idéaliste poussé à la névrose et/ou au suicide par des forces systémiques castratrices et asphyxiantes : c’est Charlie Castle (Jack Palance), acteur broyé par le système hollywoodien dans Le grand couteau, Burt Reynolds, flic blasé qui mourra sans avoir pu réaliser son rêve d’échappée romaine (La cité des dangers), et bien sûr Burt Lancaster détruit par la pieuvre militaire dans L’ultimatum des trois mercenaires.
Dans son avant‑dernier film, Aldrich confie à Lancaster le rôle d’un général de l’armée américaine qui a décidé de s’introduire, avec deux comparses, dans un silo militaire afin de prendre le contrôle de missiles nucléaires. L’homme impose alors ses conditions au président lui‑même : de l’argent, un avion à disposition et surtout, il exige qu’on révèle le contenu d’un document confidentiel sur l’engagement américain au Vietnam.
Co‑produit par la firme allemande Lorimar, le budget de L’ultimatum est réduit, mais Aldrich compense ce manque de moyens par un art infaillible de la mise en scène, une humeur rageuse (quel brûlot politique !) et un suspense efficace. Nous sommes à la fin des années 1970 et le film saisit parfaitement l’humeur désenchantée d’un pays lessivé par une décennie de mensonges (les assassinats politique, la guerre, le scandale du Watergate, etc.). Notons enfin qu’on découvre pour la première fois la version restaurée et intégrale de ce film qui, à l’époque de sa sortie en salles, fut largement mutilé. Un grand film désespéré.