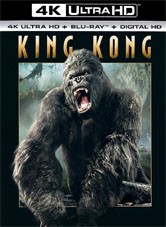King Kong
En 2005, Peter Jackson réalise enfin son rêve d'enfant : le remake du film qui déclencha sa passion précoce pour le cinéma. Si l'on en croit la légende, le jeune Néo-Zélandais bidouilla même une première version de King Kong à l'âge de 12 ans, avec un gorille en peluche et un Empire State Building en carton. Approche artisanale qui fit d'ailleurs tout le prix de ses premiers films, Bad Taste et surtout Meet the Feebles, pochades délirantes et impures innervées par un enthousiasme sans borne.
Mais le succès aidant, Jackson s'attaqua à des projets plus ambitieux. Résultat : la trilogie du Seigneur des anneaux. Un succès interplanétaire qui lui permit de ressortir de ses tiroirs son vieux rêve simiesque : King Kong. Son Titanic à lui. Car les deux films, volontairement ou non, se ressemblent. Aussi bien esthétiquement (permanence des couchers solaires, plans de l'héroïne sur la proue du bateau, naufrage évité de peu), que dans l'assourdissante campagne marketing mise en place.
À l'instar du film de Cameron à l'époque, King Kong fut vendu non pas comme un film de monstres (et pourtant, il en regorge), mais comme un conte romantique. Ce qu'il est, puisqu'au couple Di Caprio/Winslet, Jackson substitue une Belle (Naomi Watts, excellente) et une Bête (magnifique et incarnée). Mais leur histoire d'amour se retrouve expurgée de toute forme d'érotisme, contrairement à la version de John Guillermin (1976), torride en Diable. Pas de douche sous une cascade pour Naomi Watts, pas de relooking façon Jane, pas de gros doigts velus caressant son corps de déesse, mais une série de face‑à‑face ludiques et asexués : Naomi danse pour Kong, Kong fait des ronds sur la patinoire de Central Park pour Naomi (séquence presque ridicule mais réussie).
Film familial donc (certaines scènes sont tout de même impressionnantes pour les plus jeunes), qui absorbe toute la violence du mythe (pas une goutte de sang et pas l'ombre d'un sein) au profit d'un romantisme bon enfant. Dès lors, deux façons de considérer le film : selon qu'on le juge à l'aune du désir de Peter Jackson (refaire le King Kong de Schoedsack et Cooper avec plus de moyens), ou à celle de l'attente (légitime) d'une nouvelle vision du mythe. En technocrate (ceux qui pestent contre les défauts techniques, contre l'absence de vent au sommet de l'Empire, contre l'invraisemblance de la ruée des brontosaures…), ou en cinéphile.
C'est dans la tension entre ces deux approches -qui cohabitent sans jamais s'entendre- que réside l'intérêt majeur du film. À plusieurs reprises, on sent que Peter Jackson est tiraillé entre la volonté de refaire l'original, quitte à s'oublier lui-même (seul le fétiche compte), et celle d'imprimer sa marque au mythe. La séquence de la jungle, gigantesque excroissance du récit au cours de laquelle une poignée d'hommes affronte tyrannosaures, brontosaures, cafards géants, chauve-souris belliqueuses et autres méga-bestioles gluantes, fonctionne parce qu'elle relève exclusivement du spectacle. Son emballement témoigne de la jouissance ado d'un cinéaste surexcité par les capacités de son jouet de luxe. Mais dès qu'il se retrouve confronté à un problème de sens (de quoi parle le film, au juste ?), Jackson apparaît démuni.
Il y a dans le film une idée formidable, une idée de scénariste que Jackson n'a visiblement pas comprise : un jeune matelot a décidé d'emporter avec lui le roman de Conrad, Au cœur des ténèbres. Après tout, le récit d'Apocalypse Now n'est pas si éloigné de celui de King Kong (voyage initiatique aux confins de la civilisation, traque et découverte d'un monstre régnant sur une peuplade d'indigènes), et l'on se dit que le frottement des deux mythes fera des étincelles. Certes, mais dans un film que nous ne verrons pas. En attendant, Jackson est un excellent faiseur de films, dénué de toute vision personnelle mais enthousiaste. Et ça marche.