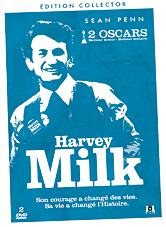Harvey Milk
Il restera dans l’Histoire comme le premier homme politique américain à avoir affiché clairement son homosexualité.
Élu conseiller municipal à la Mairie de San Francisco en 1977, Harvey Milk fit des droits de la communauté gay son principal cheval de bataille. Il fut assassiné le 27 novembre 1978 par Dan White, l’un de ses collègues superviseurs, ex-flic et représentant de l’aile puritaine et droitière de la ville. Arguant de problèmes domestiques, les avocats de White parvinrent à convaincre le jury d’homicide involontaire. Résultat, un verdict (sept ans de prison) qui provoqua l’une des émeutes les plus importantes et violentes qu’ai connu la ville.
Peu de temps avant sa mort, Harvey Milk, conscient du danger qu’il incarnait pour les bigots de tous poils, enregistra une série de cassettes audio. Un bilan en forme de flash-back où l’homme, 48 ans, évoque son arrivée dans le quartier irlando-gay (Castro) de San Francisco avec son compagnon de l’époque, sa passion tardive pour l’activisme gay, ses premiers pas à la Mairie de San Francisco, le durcissement des mœurs au milieu des années 1970 sous l’impulsion d’Anita Bryant, la pasionaria des Conservateurs, la fragilité des alliances politiques et surtout son principal fait d’armes : le rejet de la proposition N°6 présentée par le sénateur Briggs, censée autoriser le licenciement des enseignants homosexuels.
C’est par ces images d’enregistrement que débutait le formidable documentaire de Rob Epstein et Richard Schmiechen, The Times of Harvey Milk en 1984 ; c’est par elles aussi que s’ouvre le film de Gus Van Sant. Manière de désamorcer le suspense possible du récit, mais aussi d’inscrire cet élégant biopic du côté de la tragédie, même souriante -le mélange impeccable d’images d’archives et de fiction recouvrant la trajectoire à venir du martyr Milk de ce voile mélancolique propre aux films de famille jaunis-.
On sera aussi gré à GVS d’avoir remis un peu de plomb politique dans les ailes de ces ados (Last Days, Paranoid Park), dont l’état gazeux et le désengagement intégral frôlaient l’évaporation. Harvey Milk appartient à la veine « mainstream » du cinéaste de Portland (voir Will Hunting ou À la rencontre de Forrester), ce qui constitue sa force et sa faiblesse.
Sa force : premier film ouvertement post-Obama, Harvey Milk avance à pas de velours, avec tact et finesse, trouvant le juste équilibre entre les combats d’une Amérique révolue (les Seventies, la contre-culture, son retour de bâton…) et ceux de l’Amérique contemporaine (en filigrane pendant tout le film : le mariage gay, l’accession des minorités aux postes de pouvoir…).
Et puis, Sean Penn est prodigieux, nuancé, charmant, inquiet, culte, tantôt enthousiaste, tantôt découragé. Il irradie tout le film sans jamais l’écraser. Il est, pour le spectateur, l’alpha et l’oméga de tous les plans. Mickey Rourke, pourtant parfait dans The Wrestler, n’a pas à avoir de regrets.
La faiblesse du film ? En face de Penn/Milk, personne, ou presque. D’un côté, des disciples et des amants de passage, de l’autre, des opposants monolithiques, intolérants, authentiques mais caricaturaux. GVS verse donc dans l’hagiographie (black-out total sur les ambiguïtés du mouvement gay), avec une extrême prudence stylistique -l’installation de Milk et de son amant à San Francisco constituant l’un des rares moments d’invention formelle du film-.
Au fond, manque l’alter ego de Milk, son double et son refoulé, ce compagnon devenu son assassin : Dan White, alias Josh -George W.- Brolin, dont le personnage insuffisamment développé empêche la dialectique de s’installer. Cette impression qu’entre les préjugés débiles des uns et la bonne cause des autres, une autre position, plus subtile, plus problématique, était possible.