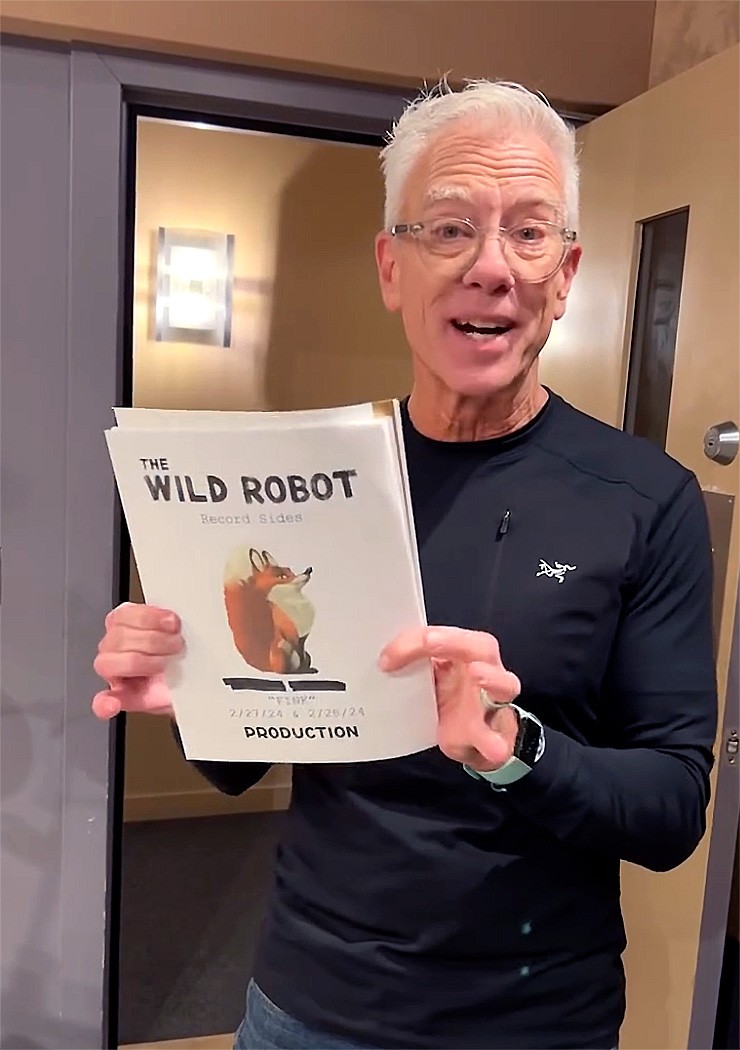Harry Brown
C’est l’histoire d’un vieux Monsieur irréprochable, british jusqu’au bout des ongles, qui trimballe sa dégaine fatiguée et son feutre beige impeccable dans un quartier malfamé de Londres ou de sa banlieue.
77 ans, Harry Brown est incarné par Michael Caine qui, après avoir été l’une des figures de proue du thriller et du film d’espionnage dans les années 1970 (héritage dont le film ne manque pas de se souvenir), appartient désormais au club très fermé des old timers élégants du cinéma, aux côtés de Hackman et Eastwood.
Symbole de la mainmise d’une racaille plus universelle que strictement britannique sur ces barres d’immeubles miteuses (violence gratuite, capuche et Q.I au ras du bitume), un tunnel sombre et graffité digne de celui qui ouvrait The Offense, tenu ici par des grappes de petits caïds oisifs. Certes, Brown a peur, comme tous les habitants du coin, mais la mort de sa femme et celle, soudaine, de son vieux compagnon de solitude, assassiné par une bande façon Orange mécanique, le replace très vite dans les clous du « vigilante movie » : toujours se méfier de celui qui n’a plus rien à perdre et veut se venger. Heureusement, Papy Brown a autrefois servi dans les Marines, contrairement à son ancêtre Charles Bronson dans Un justicier dans la ville, que la vue du premier sang versé faisait vomir, d’où son calme et sa sûreté de surface.
Résultat, lorsque le crocodile se réveille, il mord vite et juste. On peut douter que Brown ait lu le petit missel de Stéphane Hessel, si l'on en juge par le sort réjouissant qu’il réserve à une inspectrice de police toute frêle, genre assistante sociale sortie d’un film de Ken Loach violemment projetée à l’intérieur d’un clip de rap moyen, et dont le réflexe compassionnel se heurte à une bande de délinquants dont l’humanité reste à prouver. Voir ce dialogue de sourds qu’exprime la formidable scène d’interrogatoire où la jeune femme tente de calmer, en vain, la furie misogyne d’un malfrat boutonneux en lui rappelant les abus sexuels dont, d’une famille d’accueil l’autre, il aurait été victime.
Dans Harry Brown, l’indignation dont parlait Hessel appartient à l’Histoire ancienne de la dégradation sociale. Face à ce personnage épris d’action (mais qui a pris le temps d’observer le monde et de le reconnaître avant de vouloir le modifier), elle resurgit toute nue et ridicule, éternel paravent mystique que l’on dresse face à une réalité sur laquelle on n'a plus prise.
Certes, le film de Daniel Barber n’est pas exempt de défauts (le coup de théâtre final expliquant les rapports entre certains personnages, des scènes d’émeutes un peu convenues…), mais son jusqu’auboutisme lui permet de résister aux sirènes confortables du déterminisme social (le délinquant a ses raisons que la Loi connaît trop bien) et ne transforme pas la croisade de son vieux justicier en un baroud initiatique ouvrant à la découverte de l’Autre. Ici, l’Autre est trop radical, au sens baudrillardien du terme, pour que la vengeance de Brown emprunte la voie réconciliatrice de Walt Kowalski dans Gran Torino. Pas de gangster‑victime qui viendrait subitement rééquilibrer les forces, pas de kakou encapuché frappé par un éclair de conscience, mais un monde rouge feu qui, à l’image de l’antre apocalyptique de deux dealers, ressemble à L’enfer de Bosch filmé par Gaspar Noé.