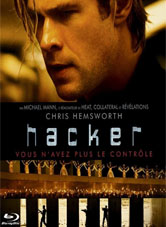Hacker
Six ans après Public Enemies, Michael Mann revient avec Blackhat ‑en français Hacker‑ un film d’avant‑garde prodigieux, inquiet, gris anthracite, froid, qui avance masqué sous les traits d’un action movie post‑11 septembre. Le film fut un échec retentissant aux États‑Unis, ce qui obligera sans doute Mann, 72 ans, à rebattre les cartes de sa carrière.
Tout commence dans les airs, et dans le silence, par une vue de la Terre semblable à une gangue glacée, à l’intérieur de laquelle la caméra s’engouffre, pénètre au cœur de circuits informatiques jusqu’à une minuscule diode dont l’allumage va provoquer l’explosion d’un silo nucléaire. La catastrophe a lieu à Hong‑Kong et déclenche l’action concertée des autorités chinoises et américaines, lesquelles décident de libérer un hacker surdoué, Nick Hathaway, sorte de Snake Plissken 2.0 interprété par Chris Hemsworth (Thor), afin qu’il les aide dans leur traque d’un cybercriminel sur lequel on ne sait rien, sinon qu’il est capable de provoquer, à distance, des catastrophes économiques, humaines et écologiques.
La première fois qu’on découvre Hathaway, dans sa cellule et casque sur les oreilles, il lit Foucault, Surveiller et punir. Sur une petite étagère, d’autres classiques apparaissent, comme Baudrillard (Le système des objets) ou Lyotard. Drôle de coming out existentiel, presque un peu trop littéral, comme si on ne savait pas déjà (depuis Le sixième sens ? Heat ?) combien les théories post‑modernes appartiennent à l’ADN du cinéma de Michael Mann, qu’il s’agisse de son obsession de l’éclatement identitaire, du déclin de l’affect ou de l’angoisse cartographique.
À peine sorti de prison, Hathaway fait bloc avec une jeune Chinoise et son frère, et plonge dans une aventure « escapiste » folle, où l’on saute à la faveur d’un clic de Washington à Djakarta. Le couple formé par Hathaway et Lien Chen (Tang Wei), qui évoque le duo Colin Farrell/Gong Li dans Miami Vice, se forme à vitesse grand V, d’un regard, comme une évidence sur laquelle Mann ne veut pas s’attarder, une convention à rétablir illico tant ce qui travaille le film est ailleurs, du côté d’une technologie fascinante et anxiogène (des pixels, des programmes, des procédures techniques, des écrans d’ordinateur) face à laquelle l’humanité, si elle veut survivre, doit taire ses états d’âme, ses clivages, et avancer soudée. Pas le temps de se courtiser ou de profiter de la liberté, pas le temps non plus de savoir de quel bois psychologique se chauffent les uns et les autres, ce qui explique, au passage, comment Mann a pu passer en trente ans d’acteurs monstres et incarnés (Caan, Pacino, De Niro) à des corps réceptacles, sans véritable envergure (Farell, Hemsworth, Depp).
Blackhat cale son tempo sur la vitesse des flux et de la technologie, Miami Vice à la puissance mille, des cours de la bourse et des torrents d’information. Un plan du market déserté de Chicago évoque d’ailleurs les séquences de la bourse romaine dans L’éclipse d’Antonioni, ça tombe bien : Blackhat possède ceci d’antonionien qu’à l’exception de deux séquences de fusillade stupéfiantes, à l’ancienne, et conséquences des effets collatéraux de la cybercriminalité, il rend sensible la fragilité de l’humanité, traitée comme l’acouphène d’une technologie qui, au fond, n’a plus besoin de nous pour exister et se déployer.
À côté des cadavres, les balises électroniques continuent d’émettre. Mann cherche plus à rendre compte d’un état du monde, à en saisir la beauté et l’énigme, la juste rumeur, qu’il ne suit la piste d’un récit criminel, réduit ici à son ossature la plus simple et codée, presque minimaliste, au risque de perdre en rase campagne une bonne partie de des spectateurs venus voir un film (un blockbuster sur fond de cyberterrorisme) qu’ils ne verront pas. Ou pas vraiment.
Ce qu’ils verront, à condition d’ouvrir un peu les yeux, est plus puissant. Cela ressemble à ce mot de Panosky sur la mélancolie, humeur manienne par excellence qui « n’est pas tendue vers un objet qui n’existerait pas, mais vers un problème qui ne peut être résolu ».