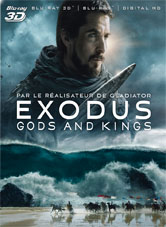Exodus, Gods and Kings 3D
Un soir, Moïse (Christian Bale), élevé au sein de la cour royale d’Égypte, découvre ses racines juives, se laisse pousser la barbe, arrête de maltraiter les chèvres, jette ce mascara ridicule que portent tous les membres de la cour et baisse soudainement le ton de sa voix. On le sait tous, au moins depuis Charlton Heston dans Les dix commandements, le prophète s’exprime à voix basse, très basse, limite rocailleuse. Son buisson ardent, par lequel Dieu se révèle à lui, prend ici la forme d’un gamin de 11 ans très sérieux, qui lui indique le pourquoi (libérer les esclaves juifs du joug égyptien et les conduire sur leur terre promise), le comment (entraînement intensif et paramilitaire de ses ouailles) et le sens (la mer Rouge) de sa mission.
Les bigots ne seront sans doute pas à la fête devant la vision très « Nouveau Testament » de Ridley Scott, qui transforme ici le prophète en chef de guerre obsessionnel, individualiste et sanguinaire. Plus Alexandre d’Oliver Stone (mais sans sa folie psyché‑pathologique) que La Bible de John Huston. Moïse est donc seul, tout seul, et conduit son peuple comme un illuminé, soit le contraire du héros fordien, toujours attentif et concerné par sa communauté.
Résultat : à l’exception de John Turturro qui, dans le rôle de Séthi, trouve un court espace pour exister vraiment à l’écran, tous les personnages secondaires du film sont réduits à des silhouettes, à une poignée de répliques fonctionnelles, qu’il s’agisse de Ben Kingsley, de Sigourney Weaver ou de Hiam Abbass. Tandis que le musculeux Joel Edgerton, dans le rôle du mauvais pharaon Ramsès, mâche du chewing‑gum, fait mumuse avec des serpents et se demande visiblement pourquoi ce n’est pas lui qu’on a choisi pour jouer dans Fast & Furious.
Exodus résume assez bien l’impasse esthétique où butent tous ces péplums contemporains (et Scott fut aux avant‑postes de cette nouvelle donne avec son Gladiator en 2000), désireux de retrouver le souffle épique et grandiose des films de Cecil B. de Mille et de David Lean, mais avec les moyens illimités et glaciaux de l’image numérique. Souvenez‑vous dans Cléopâtre, Lawrence d’Arabie ou Les dix commandements, de la puissance de fascination de ces grands mouvements de foule, de ces plans d’ensemble révélant une ville romaine ou antique toute entière, avec ces milliers de figurants en chair et en os, ces décors reconstruits pour de bon sur les plateaux des studios ou dans un désert marocain.
Ici, c’est la même chose, puissance dix, des images numériques de plus en plus réalistes, bien faites, mais l’œil du spectateur glisse avec indifférence et lassitude sur ces tableaux balayés dans tous les sens par une caméra aérienne dont il sait d’emblée et intuitivement, qu’en réalité, celle-ci n’a survolé que du vide, un immense écran vert et une poignée d’acteurs en pagne attendant qu’on incruste autour d’eux des armées de pixels. Pas de rapport entre le grandiose et l’échelle, entre l’émerveillement du spectateur et la taille de ce qui l’image lui donne.
Bien sûr, ici ou là, une petite scène (et elles sont nombreuses : les fameuses dix plaies) fait son effet, à commencer par l’ouverture orgasmique de la mer Rouge, climax spectaculaire du film. Ridley Scott, qui n’est pas un cinéaste sentimental, a souvent su insérer dans ses récits bigger than life de fortes séquences d’intimité qui font ici cruellement défaut (voir l’épisode domestique au cours duquel Moïse se marie et apprend à son fils à jouer au baseball), mais c’était le Scott d’avant, celui d’Alien, de Blade Runner et même de La chute du faucon noir.