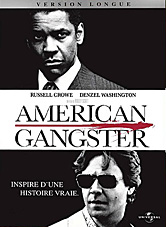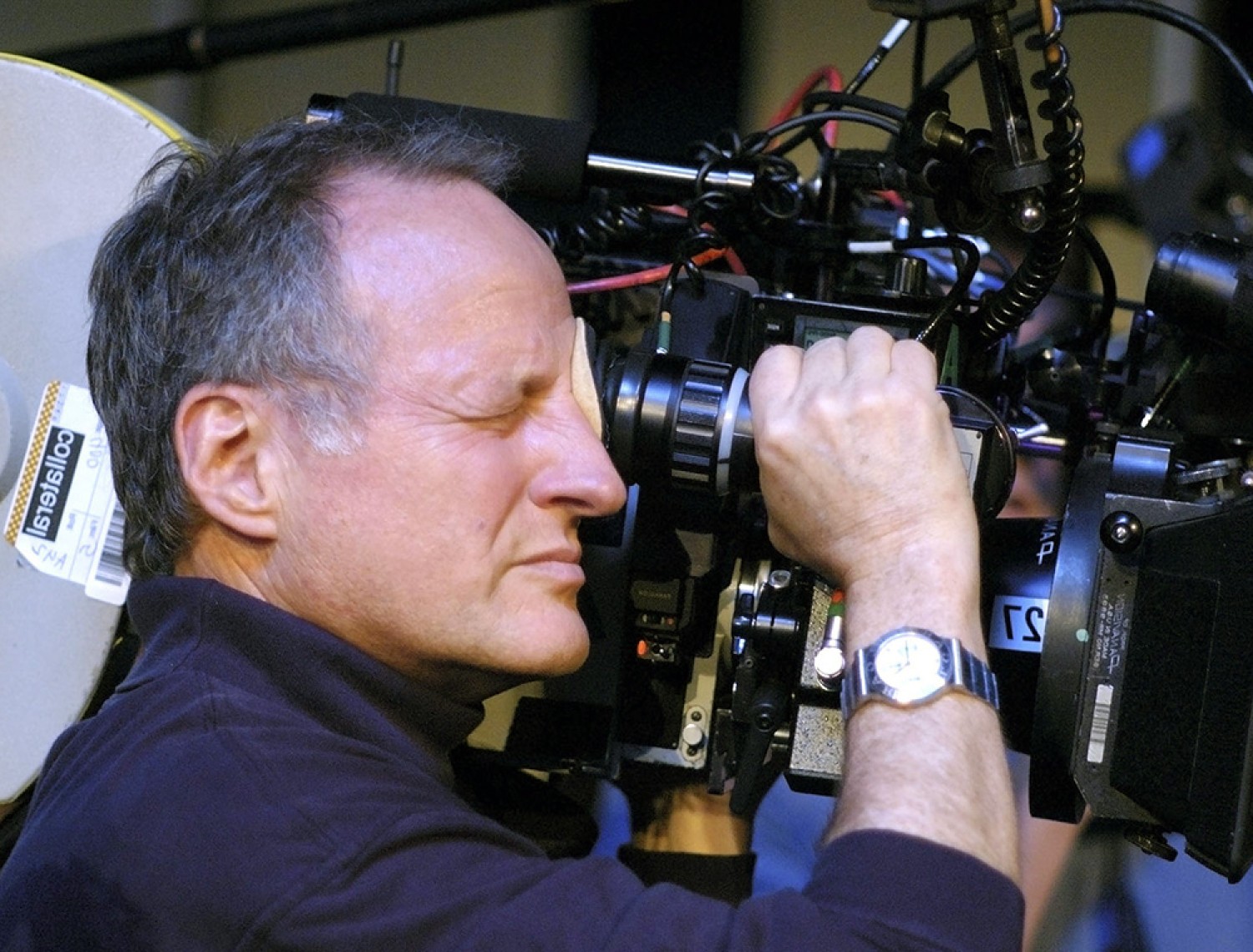American Gangster
1968. À droite, Richie Roberts (Russell Crowe), flic intègre façon Frank Serpico, qui se débat entre des collègues new-yorkais corrompus jusqu’à l’os et une procédure de divorce où se joue la garde de son fils. À gauche, Frank Lucas (Denzel Washington), chauffeur d’un parrain de Harlem récemment décédé qui, en pleine guerre du Vietnam, décide d’importer d’Asie du Sud-Est de l’héroïne pure. Son idée de génie ? Transporter la poudre en utilisant la logistique de l’armée américaine, de ses cargos militaires aux cercueils métallisés des boys de retour au pays.
En surface, American Gangster épouse la structure canonique du gangster movie, ascension et chute d’un caïd dont le petit commerce dépend de l’évolution de la guerre. Mavericks au sein de leur milieu respectif (l’un est noir et bouleverse les lois capitalistes d’une mafia blanche, et l’autre refuse de tremper dans les magouilles de ses collègues), Roberts et Lucas incarnent chacun à leur manière un code d’honneur en voie de disparition, une sorte de rectitude parfaitement classique qui n’épouse pas l’indécision des films dont le récit d'American Gangster (les Seventies) est contemporain.
Autrement dit, Scott signe un film presque anachronique qui s’immerge dans les années 70 mais n’en retrouve ni l’esprit (aucun signe de vacillement identitaire et/ou professionnel n’affecte les personnages), ni l’énergie (petite monotonie du récit qui peine à faire varier ses régimes, à sortir de ses gonds). Pendant 2 h 40, American Gangster poursuit deux lièvres à la fois (la description de deux hommes en particulier et celle d’une époque en général), et parvient à n’en saisir qu’un.